- ACCUEIL -
COLEOPTERES -
LEPIDOPTERES -
AUTRES
-VIDEOS - HISTORIETTES
- NEWS - LIENS
- WANTED
! - MAILS
d'OR
-
-

-
- L'HYDROPHILE
!
- (Hydrophilus
piceus, Coléoptère
Hydrophilidae)
-
- (page 4 sur
4)
-
- - pour quitter les
agrandissements faire "page précédente" dans votre
navigateur -
-
-
- La digestion est extra orale, mais
contrairement au Dytique il n'y a pas de véritable
inoculation des sucs digestifs, mais seulement enrobage des tissus
par simple aspersion . De la même façon l'absorption
des éléments dissous se fait de façon
conventionnelle, et non par le biais de mandibules
canaliculées.
-
- Hydrophile !

 Dytique
!
Dytique
!
- "Portraits" ... en attendant
mieux !
-
-
- Cet ensemble de considérations
fait que la larve de l'Hydrophile consomme très souvent sa
proie en la maintenant hors d'eau, et qu'à cet effet la
tête se "renverse" très typiquement sur le dos. Quand
la taille du mollusque le permet la larve de l'hydrophile
s'attable sans "effraction", en pénétrant tout
simplement dans la coquille (ci-dessous), comme le font les larves
de carabes, ou encore de lampyre (cf. pages entomo). Quand la
larve est trop grosse (ou le coquillage trop petit!), la coquille
est alors"fracturée", pour ne pas dire
découpée, car bien souvent la technique
employée est adaptée à la morphologie de la
proie (ci-dessous).
-
-


- à gauche: les
limnées sont en principe attaquées par l'apex de la
coquille; au centre: les planorbes, le sont en suivant la
spirale ...mais bien souvent les larves ne s'embarrassent
guère de fioritures ! à droite: larve
d'hydrophile (en fin de 3e et dernier stade) attablée sans
"effraction". La mollesse de la larve lui permet de
s'étirer aisément, et de pénétrer
très avant dans la coquille. Schématiquement on peut
dire que là où la tête passe, le reste
suit.
-
-
- Au terme de sa croissance la larve
quitte l'eau pour s'aménage une logette dans la terre
meuble, et à l'occasion sous une pierre ou un morceau de
bois mort. Elle s'y transformera classiquement en nymphe puis en
insecte parfait, c.a.d. apte à perpétuer
l'espèce.
-
-
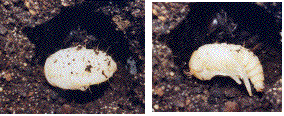
- à gauche: nymphe
d'hydrophile dans sa loge; à droite: la même
en position latérale.
-
- A noter que la position de gauche est la
norme chez l'Hydrophile, mais qu'elle est très inhabituelle
chez les Coléoptères. L'équilibre est obtenu
grâce à un triple appui (ci-dessous) constitué
par de longues et très fortes soies situées de
chaque côté du thorax, et par une double
"béquille" prolongeant l'extrémité abdominale
A noter encore que la nymphe est très mobile, et qu'elle se
remet sysématiquement dans cette position. A noter enfin,
mais c'est là une hypothèse, que la nymphe s'isole
ainsi d'un possible excès d'humidité, voire
d'infiltrations, les loges étant creusées à
proximité immédiate de l'eau.
-
- nymphe
d'hydrophile...


 ...tous
azimuts!
...tous
azimuts!
- de gauche à
droite: vue ventrale, latérale, et
dorsale
- Sur la vue dorsale remarquer le
"tripode" (flèches) qui permet à la nymphe de se
stabiliser dans cette position.
-
-
-




- de gauche à droite:
1)- nymphe d'Hydrophile très pigmentée, et donc
à quelques heures de la mue imaginale.
- 2)- Hydrophile venant de
faire sa mue imaginale. 3)- 5 h plus tard, le même en
cours de maturation
- (acquisition progressive de la
coloration, et de la sclérification = durcissemment)
4)- ... et à terme
!
-
-
- les
"essaimages"
-
 En
dépit de son volume l'Hydrophile est parfaitement apte au
vol (comme l'est d'ailleurs le Dytique), et les ailes membraneuses
sont développées en conséquence (ci-contre).
En temps normal il n'use que peu de cette faculté, si ce
n'est par obligation, autrement dit pour quitter un biotope devenu
défavorable. Par contre, au plus fort de
l'été, on observe des envols crépusculaires
ou nocturnes, souvent massifs, et assimilables à de
véritables essaimages. Outre un "brassage" des populations
il s'ensuit la conquête de nouveaux espaces, ou la
reconquête de milieux un temps abandonnés, mais
redevenus favorables.
En
dépit de son volume l'Hydrophile est parfaitement apte au
vol (comme l'est d'ailleurs le Dytique), et les ailes membraneuses
sont développées en conséquence (ci-contre).
En temps normal il n'use que peu de cette faculté, si ce
n'est par obligation, autrement dit pour quitter un biotope devenu
défavorable. Par contre, au plus fort de
l'été, on observe des envols crépusculaires
ou nocturnes, souvent massifs, et assimilables à de
véritables essaimages. Outre un "brassage" des populations
il s'ensuit la conquête de nouveaux espaces, ou la
reconquête de milieux un temps abandonnés, mais
redevenus favorables. -
- Ces envols sont parfois très
spectaculaires, du moins là où l'espèce est
abondante, car attirés par la lumière ces insectes
peuvent s'abattre en grand nombre au pied des lampadaires, y
compris en milieu urbain. A l'occasion ils peuvent même
pénétrer dans les maisons, et y causer quelques
frayeurs, bien que totalement inoffensifs.
-
- A noter pour finir que ces envols
constituent une véritables manne pour certains
prédateurs, et notamment pour les rapaces nocturnes. J'ai
d'ailleurs eu l'occasion d'observer le fait en Vendée
(à Challans, pour être précis) où sous
chaque lampadaire d'un lotissement des dizaines d'Hydrophiles se
débattaient au sol, tous amputés de leur abdomen
(comme peuvent l'être les lucanes en milieu forestier (cf.
page entomo).
-
-
-
-

 FIN
FIN
-

- les pages entomologiques d'
andré lequet
:
http://www.insectes-net.fr

 Dytique
!
Dytique
!

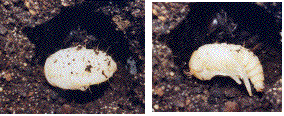


 ...tous
azimuts!
...tous
azimuts!



 En
dépit de son volume l'Hydrophile est parfaitement apte au
vol (comme l'est d'ailleurs le Dytique), et les ailes membraneuses
sont développées en conséquence (ci-contre).
En temps normal il n'use que peu de cette faculté, si ce
n'est par obligation, autrement dit pour quitter un biotope devenu
défavorable. Par contre, au plus fort de
l'été, on observe des envols crépusculaires
ou nocturnes, souvent massifs, et assimilables à de
véritables essaimages. Outre un "brassage" des populations
il s'ensuit la conquête de nouveaux espaces, ou la
reconquête de milieux un temps abandonnés, mais
redevenus favorables.
En
dépit de son volume l'Hydrophile est parfaitement apte au
vol (comme l'est d'ailleurs le Dytique), et les ailes membraneuses
sont développées en conséquence (ci-contre).
En temps normal il n'use que peu de cette faculté, si ce
n'est par obligation, autrement dit pour quitter un biotope devenu
défavorable. Par contre, au plus fort de
l'été, on observe des envols crépusculaires
ou nocturnes, souvent massifs, et assimilables à de
véritables essaimages. Outre un "brassage" des populations
il s'ensuit la conquête de nouveaux espaces, ou la
reconquête de milieux un temps abandonnés, mais
redevenus favorables.