- ACCUEIL -
COLEOPTERES -
LEPIDOPTERES -
AUTRES
-VIDEOS - HISTORIETTES
- NEWS - LIENS
- WANTED
! - MAILS
d'OR
-
-

-
- Le GRAND HYDROPHILE
!
- (Hydrophilus
piceus, Coléoptère
Hydrophilidae)
-
- (page 2 sur 4)
-
- - pour quitter les
agrandissements faire "page précédente" dans votre
navigateur -
-
-
- Avec ses 50 mm, l'Hydrophile
(Hydrophilus piceus, ci-dessous), est le plus grand et le
plus imposant de nos Hydrophilidae, mais aussi des insectes
aquatiques européens. Cette famille est
représentée en France par un peu plus d'une centaine
d'espèces, en grande majorité aquatiques, ou
sub-aquatiques. Deux d'entre-elles, aux allures de coccinelles
(Genre Sphaeridium, ci-dessous à droite), se singularisent
nettement car elles préfèrent en effet "nager" dans
les excréments, et le terme prend tout son sens quand on
les voit évoluer dans une bouse fraîche!


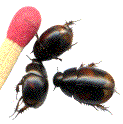
- ci-dessus et dessous: l'
Hydrophilus piceus tous azimuts !
- (ci-dessus à droite:
représentants du genre Sphaeridium, Hydrophilidae
"spécialistes" des bouses de bovidés).




-
- A noter que les Hydrophilidae sont
caractérisés par le grand développement des
palpes maxillaires (ci-dessous). La longueur de ces appendices, et
leur aspect filiforme, font qu'ils ressemblent effectivement
à des antennes, d'où le nom de "Palpicornes"
également donné à ces insectes. A noter
encore que l'Hydrophile, et quelques autres espèces
voisines, font exception par leur stature, car dans la plupart des
cas la taille des Hydrophilidae se situe en deçà du
cm.
-
-
 ...........................
...........................


- à gauche:
tête d'Hydrophilus piceus (vue ventrale).
Voir détails sur agrandissement, et
noter la longueur des palpes en regard de celle des
antennes.
- à droite: la
très longue et très acérée pointe
thoracique ventrale ... dont on ignore le rôle ! ... si
rôle il y a !
-
- Bien que parfaitement adapté
à la vie aquatique, l'Hydrophile se déplace autant
"à pattes", qu'il nage, d'où sa
préférence pour les eaux stagnantes (mares, marais,
étangs), et bien végétalisées
(lentiques notamment). En matière de natation les grands
Dytiques (genres Dytiscus et Cybister) lui sont très
supérieurs en raison d'un corps nettement plus
"hydrodynamique", et de pattes postérieures dites
natatoires (ci-dessous à droite). Ces dernières sont
en effet très aplaties, et frangées de fortes soies
qui ajoutent à la surface de la "rame", et donc à
son efficacité. Au final on peut dire que l'hydrophile
"pédale" (ce qui est d'ailleurs vrai), là où
le Dytique se propulse, et tiendrait plutôt de la Formule 1
!
-
-

- Le Cybister
lateralimarginalis
- Il est particulièrement
profilé et "hydrodynamique", mais aussi véloce
grâce à ses pattes postérieures natatoires. A
noter que les soies se replient lorsque l'insecte ramène la
patte, et qu'elles se déploient lorsqu'il la pousse,
d'où une grande surface de propulsion.
-
-
- Au titre des comparaisons on ajoutera
que l'Hydrophile adulte est strictement végétarien,
que le Dytique est carnassier mais aussi nécrophage, et que
les larves des deux ont en commun d'être
carnassières, mais là aussi avec une nette tendance
à la nécrophagie. Par le "recyclage" des cadavres,
poissons par exemple, ces insectes concourent donc très
efficacement à l'assainissement des eaux.
-
- On dira encore que le Dytique pointe son
derrière en surface pour "respirer", et qu'il s'agit au
contraire du museau chez l'Hydrophile. Dans le premier cas l'air
est stocké sous les élytres, et parfois dans une
bulle qui se forme à l'extrémité abdominale
de l' insecte. Dans le second il est retenu par une sorte feutrage
spécialisé qui occupe essentiellement la partie
thoracique de la face ventrale de l'insecte. Dans ce dernier cas
l'air emmagasiné induit un spectaculaire effet de "miroir "
ou de "mercurisation" (ci-dessous) phénomène
physique et classique également observable chez d'autres
insectes aquatiques (Notonectes par exemple).
-
-


- à gauche: mise en
évidence de l'effet de miroir;
- à droite: gros
plan sur la structure de captage et rétention de l'air (ne
pas confondre avec les banales soies jaunes)
- Vous noterez que toute la partie
ventrale est concernée, à l'exclusion de
l'abdomen.
-
-
-
-



-

- les pages entomologiques d'
andré lequet
: http://www.insectes-net.fr


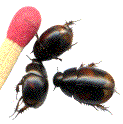
 ...........................
...........................







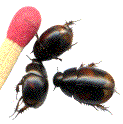
 ...........................
...........................




