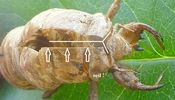- ACCUEIL -
COLEOPTERES -
LEPIDOPTERES -
AUTRES
-VIDEOS - HISTORIETTES
- NEWS - LIENS
- WANTED
! - MAILS
d'OR
-
-

-
- Les
CIGALES !
La
CIGALE PLÉBÉIENNE (Lyristes plebeja = plebejus)
... and Co !
- (Homoptères
Cicadidae)
-
- (page
3 sur 3)
-
- - pour quitter les
agrandissements, et les
vidéos, faire "page
précédente" dans votre navigateur
-
-
- Le vol !
Les cigales étant des insectes
très "massifs", leurs ailes sont amples, robustes, et
solidement nervurées. Afin d'améliorer la
qualité du vol, le couplage des ailes antérieures
avec les postérieures a été prévu par
Dame Nature, possibilité au demeurant largement
répandue chez les insectes. Les systèmes
d'accrochages sont variés, toujours efficients, et parfois
très originaux, tel le "joug" de certains papillons
nocturnes. En la matière notre cigale fait
particulièrement simple puisqu'il s'agit d'une courte
gouttière fonctionnant sur le principe d'un
"clip".
Sensiblement située au milieu de
la nervure antérieure de l'aile postérieure, cette
gouttière se clipse sur une zone "faite pour" de la nervure
postérieure de l'aile antérieure. Vous noterez que
le clipsage est très librement coulissant, d'où une
parfaite adaptation aux mouvements alaires induits par les
évolutions aériennes de la
bestiole..
-
 ..................
.................. 
 ..................
..................

- à gauche : cigale
plébéienne "étalée". Vous noterez
l'uniformité des ailes, leur parfaite transparence, et la
présence d'une nervure dite "bordante", délimitant
une étroite bordure périphérique
dépourvue de tout renfort, et donc particulièrement
fragile; au centre : ailes isolées montrant
l'efficacité du clipsage; à droite :
illustration comparative du très original couplage des
ailes chez les papillons de type "Sphinx", où une bride
"élastique" de l'aile antérieure s'enroule autour
d'une forte soie articulée de l'aile
postérieure.
-
-



- ... et pour bien comprendre
!
- à gauche:
repérage de la zone de clipsage (voir agrandissement);
au centre : gros plan sur la bordure supérieure de
l'aile inférieure,
- avec mise en évidence de
la gouttière formant "clip"; à droite: gros
plan sur le couplage des ailes par clipsage.
-
La larve !
Qualifiées
d'hémimétaboles les cigales sont des insectes à
métamorphoses incomplètes. La croissance de la larve et
son passage à l'état d'insecte adulte se font en effet
progressivement, au gré de mues successives (le plus souvent
7).
À l' éclosion,
généralement en septembre-octobre, les jeunes
"pré-larves" émergent, et muent quasiment dans la
foulée. Telle une araignée au bout de son fil, la jeune
larvule peut rester appendue à une sorte de court filament
avant de se laisser choir au sol, et de s'y enfouir pour un
développement demandant plusieurs années (le plus
souvent 4, mais 5 pour L. plebeja). Tout comme l'adulte la
larve possède un rostre lui permettant de piquer les racines
des arbres et arbustes, afin d'y prélever les sucs
nécessaires à sa subsistance.
Les larves sont "outillées" pour
creuser et elles ne s'en privent pas, mais elles ne font pas de
véritables galeries, du moins au sens habituel du terme. Au
fur et à mesure de la progression, les déblais issus du
creusement sont en effet "évacués" vers
l'arrière et colmatent ainsi la partie
précédemment creusée. Taillé en forme de
coin le "museau" de la larve prend une part active dans cette
évacuation en refoulant les déblais
latéralement.
- Là où la nature du terrain
l'y oblige ( trop dur, trop sec, ou encore trop friable par
exemple), la bestiole met son urine à profit pour amollir
le substrat, et au besoin "maçonner" sa galerie. Selon
Michel Boulard (1988) l'urine émise à cet effet
emprunte des gouttières ventrales "faites pour", lesquelles
débouchent au niveau des pattes fouisseuses, et donc
à pied d'oeuvre. De plus Dame Nature n'a pas
lésiné car l'urine de la gent cigale comporte un
véritable "liant", lequel ajoute à la
solidité des parois ... et à la
sécurité de la "tunnelière" !
-
- Au terme de sa vie souterraine la
"larve" de cigale (en fait la nymphe) gagne l'air libre et grimpe
sur la végétation environnante (grandes herbes,
buissons, troncs d'arbres, etc…). Solidement agrippée
elle y fera alors sa mue dite imaginale, et donnera au final un
insecte dit "parfait", c.a.d. apte à se reproduire, et
à chanter pour notre plus grand plaisir … s'il s'agit
d'un mâle !
-



- ci-dessus : venant de
sortir de terre, et cramponnées à leur support
(écorce d'un arbre, et bois mort)
- ces nymphes de cigales sont
prêtes pour effectuer leur mue dite
"imaginale".
- ci-dessous à gauche :
exemples d'exuvies imaginales (suite du passage au stade l'adulte,
je le rappelle ! ) de L. plebeja;
au centre : chitine oblige, la
mue du très fin stylet et de sa gaine rendent parfaitement
compte de ce qu'ils étaient sur le vif ... et seront au
stade adulte ! à droite : exemples d'exuvies in
natura. Tous les supports sont bons, dès l'instant
où ils sont censément hors sol et permettent
à la bestiole de s'accrocher pour développer et
sécher ses ailes (végétaux herbacés et
ligneux, troncs des arbres, bois mort à terre, rochers,
murs, murets, clôtures en tous genres, etc ... ).

 .............
.............  .............
............. 

-
-
-



- à gauche : naturellement
blanches, et constituées d'un fil de chitine
extrêmement fin enroulé à spires jointives
(tel un ressort), les nombreuses trachées respiratoires
muent également. En dehors des troncs trachéens
principaux, les ramifications sont nombreuses, souvent très
fines, voire ténues, mais l'exuviation a pour effet de les
compacter; au centre : la vue ventrale de l'exuvie permet
de constater la présence de forts replis latéraux
(épipleuraux ? ) assurant la protection des orifices
trachéens visibles sur la vue suivante; à droite
: mise en évidence des orifices trachéens ( =
stigmates), par soulèvement du repli protecteur.
Appel à spécialistes "es
cigales" : bien visibles ci-dessus, car plus clairs, plus
minces, et différemment structurés, les segments
abdominaux ventraux (= sternites) proprement dits
présentent la curieuse particularité d'être
nettement "hydrophobes" (et cela en dépit de
l'ancienneté du "stockage" de ces exuvies). Sauf à
considérer qu'il s'agit de la "gouttière urinaire"
précédemment évoquée, hypothèse
me semblant plausible, j'avoue ignorer la raison d'être de
cette particularité ... d'où mon appel !
Les pattes fouisseuses
!
Les larves ( et nymphes ! ) sont
dotées de très élaborées et puissantes
pattes antérieures, dites fouisseuses, sorte de "couteau
suisse" faisant office de pioche, pelle, cisaille et tenaille
(ci-dessous). La mobilité de l'éperon terminal ( en
fait le tibia ! ) associée à sa position et à
sa conformation (apex acéré et bord interne
tranchant), fait que la patte est en effet apte à creuser,
pincer, et cisailler (radicelles par exemple).
Comme les illustrations ci-dessous le
montrent, le cisaillement apparaît d'autant plus efficace
que la partie opposable à la lame de l'éperon est
elle-même tranchante, et de surcroit dentelée pour
assurer une meilleure prise. Les 2 lames glissant l'une contre
l'autre on retrouve le principe même du sécateur, ou
de la cisaille à volaille, les lames de ces engins
étant d'ailleurs très souvent crantées pour
précisément éviter le glissement. Au final,
et une fois de plus, la notion de bionique (étude de
processus biologiques en vue de leur transposition à des
fins industrielles) s'en trouve illustrée.
Pour finir vous noterez la petitesse du
tarse, son articulation basale lui permettant de se rabattre
contre l'éperon "tibial", et d'ainsi se protéger
lors des "gros travaux" (creusements par exemple). En pratique ces
tarses finissent souvent amputés, mais leur rôle
confinant l'accessoire cela ne prête pas à
conséquence, d'autant qu'un tarse "tout neuf" prendra place
lors de la mue suivante.

 ...............
...............
 .............
............. 

- Illustration de l'aptitude au
creusement, au pincement, et au cisaillement, à partir de
pattes fouisseuses prélevées sur exuvies nymphales
de L. plebeja.
- à gauche : vue externe et
interne d'une patte droite, avec tarse "sorti". Sur
l'agrandissement de la 1e photo, vous noterez l'évolution
adaptative des composantes de la patte (tarse, tibia,
fémur); au centre : vue interne et externe d'une
patte droite, avec la "pince/cisaille" ouverte, et tarse
"rangé"; à droite : vue externe et interne
d'une patte gauche, avec "pince/cisaille" fermée, et tarse
là aussi "rangé". Vous noterez la parfaite
opposition des "crocs".
-
- Souvenirs de
Gruissan (Aude) !
- Si les cigales aiment se poser sur les
troncs et ramures des grands arbres pour y pousser leurs
stridentes "cymbalisations", leurs larves affectionnent au
contraire les terrains bien exposés. Quand l'occasion se
présente, les sols sablonneux et densément "herbus",
comme ci-dessous, sont carrément plébiscités.
Concrètement les larves émergent du sol quasiment
avec le lever du soleil, et peu après se
"métamorphosent" en cigales adultes via la mue dite
"imaginale". Une fois les téguments durcis, et la
température suffisante, les bestioles prennent leur essor
pour souvent s'installer dans les arbres afin d'y "chanter", et
s'y accoupler. In fine les femelles retourneront là
où elles sont nées pour y pondre ... et finir leur
vie !
-



- Très fournis en
végétaux variés les bords sablonneux de la
lagune de Gruissan donnent vie à de nombreuses larves de
cigales. Fin juin, entre 7 et 8 heures du matin, il était
possible d'y trouver des cigales adultes plus ou moins
récemment écloses. Ayant découvert le fait
peu avant mon départ, je n'ai pas eu l'occasion de
photographier et filmer la "totale", à savoir
l'émergence de la larve, puis son passage à
l'état d'insecte adulte ! Grrrr !




-
-
- ... et de la Grande
Motte (Hérault) !



- Le plus souvent indiscernables,
notamment en milieu herbacé, les trous de sorties des
"larves" de cigales (en fait des nymphes),
- sont ici bien visibles sur de
petites zones dénudées.
-
- Quid de la mue imaginale
!
Très schématiquement la
sécrétion du bien nommé liquide exuvial va
permettre le décollement de la future ... exuvie ! (terme
plus approprié que "mue"). Dans le même temps
l'augmentation de la pression "sanguine" (et donc de l'
hémolymphe), conjuguée à celle de l'air
absorbé, va provoquer la rupture du tégument
thoracique larvaire, selon une ligne médiane dorsale,
brièvement prolongée en "y" en avant des yeux, comme
l'illustration ci-dessous le montre.
L'ouverture ainsi
générée va permettre l'émergence
progressive de l'insecte adulte. Allant de paire la coloration
définitive et le durcissement des téguments feront
suite, le processus demandant plusieurs heures. A terme la
bestiole s'en ira vivre sa vie ( telle que prévue par Dame
Nature ! ) et entre autres "chanter" (cigale oblige ! ) … si
c'est un mâle !
-
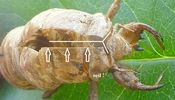
- Mise en évidence de l'ouverture
"fourchue" permettant l'émergence de l'insecte adulte, dit
"parfait", et donc apte à se reproduire. La netteté
de la rupture, soulignée par les flèches,
témoigne bien du parfait prédécoupage de la
carapace, à l'image de nos boîtes de conserves.
Là encore nous ne faisons que copier les "inventions de la
Vie".
-
- La "naissance"
d'une cigale ... comme si vous y étiez
!





- 29 minutes pour
s'extraire !




- ci-dessus : la délicate
sortie de l'enveloppe nymphale se termine par un spectaculaire et
périlleux "rétablissement" permettant de finaliser
l'extraction de l'abdomen. ci-dessous : le
déploiement des ailes, nettement plus "cool" est suivi par
le processus de coloration ( = chromatogenèse ! ) et de
durcissement ( =sclérification ! ) des
téguments.






- ... et 20 minutes
pour déployer les ailes !
- ci-dessous : 4
heures plus tard !


- Un peu en deça de
sa pleine maturité, la bête s'est néanmoins
envolée "franco" au premier
effleurement.
-
En guise de conclusion
...
- Le "temps" ...
c'est aussi cela !
Sachez que les exuvies larvaires
présentées, pattes fouisseuses comprises, ont
été "récoltées" dans l'
Hérault, à Saint Jean de Fos ... en 1986 ! Autant
dire qu'elles "ne datent pas d'hier", et cela malgré une
évidente fragilité pouvant les voir "devenir
poussière" en une fraction de seconde. Comme Ernst
Jünger l'a écrit dans son remarquable Chasses
subtiles : "Il est surprenant de voir combien
d'années ces petits objets fragiles résistent aux
injures du temps. Nous possédons encore des feuilles
d'herbier qu'ont annotées un Linné, un
Chamisso, des scarabées déterminés par
Fabricius, de Geer, le comte Dejean" .... et ces
illustres naturalistes, et précurseurs, "datent" des 17e et
18e siècle !
Toujours à propos du temps, et de son
illustration, je ferais état d'une cigale d'Amérique du
Nord, Magicicada septemdecim,
(*)
qui détient un très
étonnant record, puisque son développement larvaire, et
donc souterrain, demande en effet 17 ans. A l'inverse, et ce n'est
pas le moins étonnant, ni le moindre des paradoxes, la cigale
adulte ne vit que quelques jours, voire quelques heures, puisqu'elle
naît au crépuscule et peut passer de vie à
trépas dans la journée qui suit, sa seule raison
d'être étant d'assurer la pérennité de son
espèce. J'ajouterais que les
émergences sont massives, et donc parfaitement
synchronisées, d'où la fabuleuse précision d'un
rendez-vous pourtant fixé par la Vie 17 ans auparavant.
Au final, et je pense que vous en conviendrez,
on ne peut que rester confondu devant l'étrange
destinée de cet insecte.
- (*)
Une très étonnante séquence
consacrée à cette espèce est passée
dans le cadre d'une excellente et fort ancienne émission
télévisée (C+) intitulée "Si nous
étions des animaux", avec pour sous-titre "l'illusion du
temps".
-
- YouTube aidant,
d'innombrables vidéos sont actuellement
proposées,
- mais
celle-ci est vraiment remarquable !
-

 FIN
FIN -

- les pages entomologiques d'
andré lequet
:
http://www.insectes-net.fr
 ..................
.................. 
 ..................
..................








 .............
.............  .............
............. 





 ...............
...............
 .............
.............